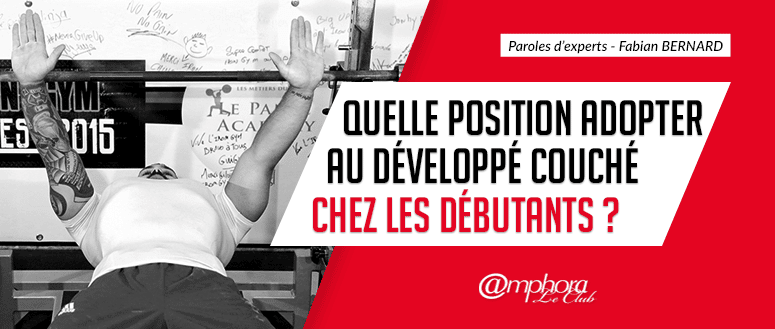Un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) peut s’appliquer sur une commune même si celle-ci dispose déjà d’un plan local d’urbanisme (PLU) en vigueur. La loi ALUR de 2014 transfère de plein droit la compétence d’élaboration du PLU à l’intercommunalité, sauf opposition de la majorité qualifiée des conseils municipaux. Pourtant, certaines communes conservent une marge d’autonomie dans la gestion de leur urbanisme, générant des situations où les règles diffèrent d’un territoire à l’autre.
La mise en place du PLUi bouleverse la répartition des pouvoirs entre communes et intercommunalités, impactant directement la planification du développement urbain local. Les enjeux sont multiples, tant pour les élus que pour les habitants et les acteurs économiques.
Comprendre le PLU et le PLUi : définitions et enjeux pour les communes
Le plan local d’urbanisme, ou PLU, pose le cadre réglementaire qui façonne chaque commune. Il fixe les règles du jeu pour l’urbanisation, le développement, la protection des espaces naturels ou bâtis. Tout se décide au niveau du conseil municipal, qui adapte son document à la réalité de la commune, guidé par le Code de l’urbanisme. Son périmètre s’arrête aux frontières communales.
Mais les besoins dépassent désormais ces limites. Face à la diversité des territoires et à la complexité des enjeux, la loi ALUR a donné naissance au plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi). Désormais, ce sont les EPCI (établissements publics de coopération intercommunale) qui prennent la main, avec un document unique pour l’ensemble de leurs communes membres. Le PLUi met l’accent sur la cohérence territoriale et la mutualisation, reléguant peu à peu les PLU communaux au rang d’archives.
| PLU | PLUi |
|---|---|
| Portée communale | Portée intercommunale |
| Adopté par le conseil municipal | Adopté par le conseil communautaire |
| Répond à des enjeux locaux | Intègre les orientations du SCoT et la mutualisation des ressources |
Prenons l’exemple du PLUi de Plaine Commune, adopté en février 2020, ou celui de la CCHB (Haut-Béarn) : ces démarches incarnent la montée en puissance de la planification à l’échelle intercommunale. Le PLUi s’inscrit dans le cadre du SCoT (schéma de cohérence territoriale) et s’impose à toutes les communes membres. Plus qu’un simple outil administratif, il devient un levier pour mieux gérer l’espace, limiter l’artificialisation des sols et inscrire la planification dans la durée. Désormais, les choix stratégiques se discutent à l’échelle de tout l’EPCI, sous le regard des politiques nationales et régionales.
Pour les communes, l’arrivée du PLUi n’est pas anodine : elles voient une partie de leur pouvoir en urbanisme passer à l’intercommunalité. Mais cette évolution ouvre aussi l’accès à plus de ressources, une meilleure coordination de l’habitat, de la mobilité, et une protection renforcée des espaces naturels. Toute la question est là : trouver l’équilibre entre actions partagées et respect des particularités locales.
PLU ou PLUi : quelles différences et pourquoi cela change tout ?
Le passage du PLU au PLUi modifie radicalement l’organisation de l’urbanisme local. Le PLU, limité à une commune, laisse place à un PLUi qui s’étend à l’ensemble des communes d’un EPCI. Ce document unique remplace les anciens PLU et cartes communales, offrant une vision globale sur tout le territoire intercommunal.
Ce changement implique une nouvelle gouvernance : les décisions ne sont plus l’apanage du seul conseil municipal, mais relèvent dorénavant du conseil communautaire. Ce transfert influe sur la manière d’appréhender l’intérêt général : il faut désormais penser à l’échelle de plusieurs communes, articuler les politiques publiques et faire de la solidarité et de la mutualisation des moyens un pilier central.
Le PLUi détermine les règles pour délivrer les autorisations d’urbanisme, organiser les zones urbaines ou naturelles, et piloter les grands projets. L’adoption du PLUi par Plaine Commune en 2020 ou par la CCHB illustre cette transformation : un document unique remplace les anciens schémas, harmonisant les choix d’aménagement.
Voici ce qui distingue fondamentalement les deux outils :
- PLU : il répond aux besoins immédiats d’une commune, au plus près des réalités du terrain.
- PLUi : il offre une gestion collective, pensée pour la cohérence de tout un bassin de vie, et structure l’aménagement à grande échelle.
Derrière ce changement, ce sont les équilibres locaux qui sont questionnés : comment préserver la singularité de chaque commune tout en avançant ensemble ? Le PLUi devient alors le socle sur lequel s’appuie l’urbanisme opérationnel, au service d’une planification durable et d’une gestion raisonnée de l’espace.
Quels impacts concrets sur la vie locale et l’aménagement du territoire ?
Le PLUi façonne concrètement le quotidien des habitants et modifie en profondeur l’organisation des communes membres. Il définit le découpage en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et zones naturelles (N). Chaque zone obéit à des règles claires : densification, protection des terres agricoles, valorisation des espaces naturels.
Le PLUi devient indispensable lorsqu’il s’agit de coordonner les grands projets intercommunaux. Tramway T8 Sud, lignes 15 Ouest et Est, ZAC Village Olympique, Fort d’Aubervilliers… Autant d’exemples où la compatibilité du document d’urbanisme conditionne la réussite des opérations. Cette organisation évite la multiplication de projets isolés, favorise l’articulation des besoins en logement, mobilité ou équipements, et garantit la cohérence à l’échelle du territoire.
Le PADD (projet d’aménagement et de développement durables) et les OAP (orientations d’aménagement et de programmation) dessinent la trajectoire du territoire pour les années à venir. Ces outils traduisent une ambition forte : limiter l’artificialisation, optimiser chaque espace, et inscrire la planification dans la durée. La révision ou la modification du PLUi se fait toujours via des procédures publiques, avec enquête et concertation, garantissant l’implication des citoyens. Le PLUi devient ainsi le support d’un débat collectif sur la ville de demain, entre gestion raisonnée de l’espace et amélioration du cadre de vie.
Mettre en place un PLUi : étapes clés, acteurs impliqués et points de vigilance
Construire un plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi), c’est engager une démarche collective et structurée. Le conseil communautaire en assure la direction, épaulé par des équipes techniques. Les communes membres, à travers leurs élus, défendent leurs spécificités, tandis que les personnes publiques associées (État, régions, départements, chambres consulaires) interviennent à chaque étape pour garantir l’équilibre entre expansion urbaine, préservation de l’agriculture et respect de l’environnement.
Voici les principales étapes qui jalonnent la création d’un PLUi, telles que le prévoit le Code de l’urbanisme :
- Délibération de prescription pour lancer la procédure
- Diagnostic territorial et élaboration du PADD
- Concertation publique obligatoire, intégrant habitants et acteurs économiques
- Consultation des personnes publiques associées, évaluation environnementale, avis de la MRAe et de la CIPENAF
- Arrêt du projet, organisation de l’enquête publique et recueil des observations
- Validation finale par le conseil communautaire ou le conseil de territoire
La concertation occupe une place centrale tout au long du processus : réunions publiques, plateformes numériques, ateliers participatifs jalonnent l’élaboration du document. À Plaine Commune, le PLUi de 2020 a illustré cette exigence de transparence et d’ouverture. La phase d’enquête publique cristallise souvent les débats et révèle les tensions. Modifications, révisions, mises à jour ou compatibilités restent possibles, sous contrôle institutionnel et avec retour systématique vers les citoyens.
L’attention doit se porter sur la clarté du processus, la lisibilité des documents et la capacité du PLUi à s’ajuster aux exigences du SCoT ou aux projets d’intérêt général. Les changements législatifs, comme le rapport triennal sur l’artificialisation des sols, obligent à une veille constante et à une adaptation continue des documents d’urbanisme.
Le PLUi ne se contente pas de redistribuer les cartes : il impose un nouveau tempo aux communes, les invite à repenser leur avenir collectif et à s’approprier ce cadre partagé. Pour les territoires engagés, impossible désormais de bâtir l’avenir seuls, sans cette boussole commune.